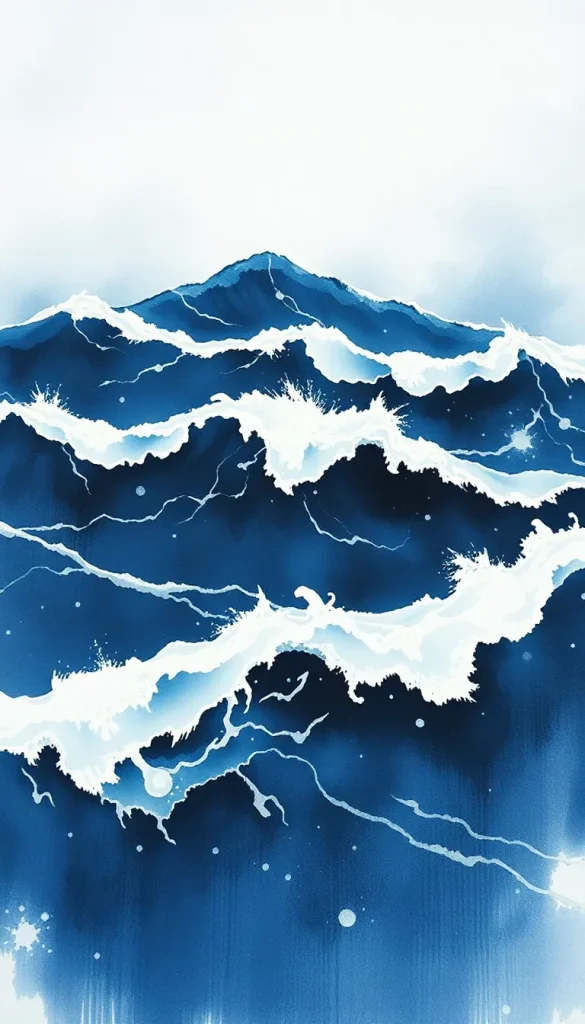Le Chant des Abîmes
Tordant les mâts qui geignaient sous l’assaut des rafales,
Et la nuit dévorait, gueule béante et traîtresse,
L’espoir fragile encore accroché aux rafales.
Ô toi dont le sourire éclairait mes hivers,
Toi dont les doigts légers guidaient mes songes vagues,
Entends-tu sur les flots mon dernier chant offert
Se perdre en sanglots sourds sous le rire des vagues ?
Trois lunes ont passé depuis l’adieu déchirant
Où ton cœur suspendu battait contre mon âme,
Trois lunes à lutter contre un destin errant,
À braver l’infini pour retrouver ta lame.
Mais Neptune, jaloux de nos serments dorés,
Déchaîna sur mon corps sa horde d’écumes folles,
Fracassant l’horizon en crêtes égarées
Où chaque vague est un glaive enfoncé dans mon rôle.
Je me souviens… Le port sentait le sel et l’ambre,
Tes cheveux dénoués dansaient avec le vent,
Et nos mains enlacées défiaient le décembre
En échangeant des mots que la brume emportait.
« Reviens », murmurais-tu, « même si les dieux te nient,
Même si tout l’océan se dresse en forteresse,
Je t’attendrai debout au bord du quai qui crie,
Jusqu’à ce que mon sang se fige en promesse. »
Hélas ! Les alcyons ne chantent plus en choeur,
Le compas a menti, trahi par les étoiles,
Et le navire, esclave ivre de sa douleur,
Se consume en craquants appels à d’autres voiles.
Soudain – ô trahison des éléments unis –
Un éclair déchira la nue convulsive,
Révélant à mes yeux un spectre infinie :
Une falaise abrupte où pleure une captive.
Ton visage ! Tes yeux brûlants d’azur et d’onde
Fixant l’horizon vide où je devais renaître,
Tes bras tendus vers rien, statue trop profonde,
Piégée dans le granit des regrets et des êtres.
« Non ! » hurlai-je au chaos qui beuglait sa victoire,
« Jamais ton cœur sublime en ces rocs ne s’étiole ! »
Et dans un geste fou d’amour et de bravoure,
Je liçai mon esprit au bois qui me viole.
D’un bond, je fus l’éclair, le souffle, le projet,
Déchirant la tourmente en deux ailes farouches,
Mon corps n’était plus chair, mais pur vecteur de jet
Vers la falaise où gît l’astre de mes reproches.
La mer hurlait plus fort, baveuse de colère,
S’acharnant à broyer mon élan téméraire,
Mais chaque coup de rame était un mot sincère,
Chaque vague esquivée un pas vers ta lumière.
Enfin – ô temps suspendu ! – mes doigts ensanglantés
Efficurèrent le bord de ton île maudite,
Et dans un cri muet de douleur et d’été,
Je t’arrachai au roc par ma folle conduite.
« Fuis ! » ordonnai-je à l’âme éparse dans les roches,
« Que jamais ton regard ne croise cette houle !
Porte au loin notre amour comme un feuille qui cloche,
Et laisse-moi payer la dette qui me houle. »
Tu résistais, pleurant des larmes de nacre pure,
Accrochée à mes bras ruisselants d’embruns fous,
Mais le destin déjà scellait notre rupture
Dans la cire des cieux indifférents et mous.
D’un baiser plus amer que les lèvres des morts,
Je te poussai vers l’aube où se meurt la tempête,
Et m’abîmai d’un coup dans le chœur des remords
Où m’attendaient, goguenards, les dents de la bête.
Le navire sombra dans un soupir de sel,
Les planches en pleurant leur cargaison d’ivresse,
Et je devins écume, et je devins éternel,
Spectre fluide errant dans la nuit vaste et épaisse.
Toi, tu cours chaque aurore au rivage natal,
Scrutant l’écume blanche où se cachent mes rides,
Ignorant que mon souffle est ce vent matinal
Qui caresse tes cils lourds de marées livides.
Et quand vient le midi brûlant de souvenirs,
Je murmure ton nom aux algues éphémères,
Tandis que les dauphins, complices de plaisir,
Dessinent ton sourire en leurs bonds éphémères.
Mais les siècles ont beau déchirer leur manteau,
Rien ne rompt le silence où mon âme se vautre,
Car aimer d’outre-mort est un crime si beau
Qu’il condamne à jamais le cœur qui s’y rencontre.
Ainsi gémit la brume au creux des nuits sans fin,
Ainsi saigne l’amour sur la pierre des digues :
Le marin n’est plus qu’ombre errant de récif en récif,
Et la femme, écho vain qui mendie les ligues.
Ô vous qui naviguez sur les flots du hasard,
Apprenez que les dieux jaloux gardent leurs portes :
Le plus grand des combats n’est pas de prendre part,
Mais d’offrir son néant pour que l’autre en sorte.
La mer garde mon corps, le vent chante mes maux,
Tes pas creusent la plage en attente stérile,
Et l’univers se tait, car les plus beaux flambeaux
S’éteignent toujours dans l’aurore inutile.
« `